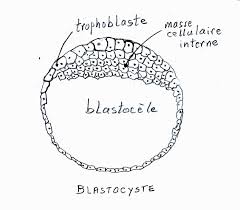Voici mon très court Plan:
- Définition
- Étapes enzymatiques
- Bilan total
- Quelques implications en pathologie
I. DÉFINITION
La Glycolyse est le processus par lequel le glucose est métabolisé pour un but énergétique cellulaire. Classiquement, lorsqu'on parle de la glycolyse, on ne fait allusion qu'à la transformation du glucose en pyruvate mais nous prolongerons jusqu'au cycle de Krebs qui n'est rien d'autre qu'une suite logique de cette glycolyse en cas d'aérobiose.
II. ÉTAPES ENZYMATIQUES DE LA GLYCOLYSE
En effet, il nous faut revenir au début, l'entrée du glucose dans la cellule.
Le glucose pénètre dans les cellules de deux façons différentes : avec et sans l'insuline. L'insuline permet son entrée dans les adipocytes, myocytes, hépatocytes et autres cellules alors que dans les neurones et les érythrocytes, voire les cellules du tube contourné proximal, la pénétration est non insulino-dépendante.
Dans le mode insulino-dépendant, il y a intervention des GLUT (1-7, mais le plus fréquemment rencontré est le GLUT-4). Dans le mode non insulino-dépendant, il y a le cotransport Na-Glucose.
Une fois dans la cellule, le glucose connait 3 grandes phases en aérobie sinon une seule en anaérobie :
- Glycolyse
- Décarboxylation oxydative
- Cycle de l'acide citrique
En anaérobie, seule la glycolyse est possible.
A. GLYCOLYSE (the main topic)
|Note: Cliquez sur les images pour les voir avec plus de détails|
Elle se déroule classiquement en 10 étapes:
1. Phosphorylation du glucose par l'ATP grâce à une hexokinase
Les hexokinases sont rencontrées dans nombreuses cellules de l'organisme et sont non spécifiques: elles peuvent phosphoryler n'importe quel hexose (galactose, fructose, manose, glucose) mais l'hexokinase spécifique au glucose est la glucokinase.
Ladite phosphorylation se fait en position 6 pour obtenir le Glucose-6-phosphate.
2. Isomérisation du G-6-P en Fructose-6-phosphate
Réalisée grâce à phosphoglucoisomérase.
3. Phosphorylation nouvelle du fructose-6-phosphate à la position 1
En plus du phosphate dont il (le fructose) a hérité le du glucose, qui, lui, était phosphorylé dès le début de la glycolyse, le fructose acquiert au cours de cette réaction un deuxième en position 1. C'est ainsi que grâce à cette réaction se forme le Fructose-1-6-biphosphate (F-1-6-bis).
C'est catalysé par la phosphofructokinase 1.
4. Clivage du F-1-6-bis
Le fructose-1-6-bis (C6) sera scindé en deux composés C3 grâce à une aldolase: fructose-1-6-biphosphate aldolase.
Ces composés C3 (trioses) ne sont que le glyceraldéhyde et le dihydroxyacétone.
5. Interconversion des trioses phosphates
Ce qui est constaté c'est le passage du 3-P-dihydroxyacétone en 3-P-glyceraldéhyde de sorte à obtenir 2 3-P-glyceraldéhydes.
C'est une réaction réversible médiée par la phosphotriose isomérase.
6. Oxydation du 3-P-glyceraldéhyde en 3-P-glycérol
C'est grâce à la phosphoglyceraldéhyde isomérase. Il y a ici production du NADH.
7. Formation de l'ATP par transfert du phosphate du glycérol sur ADP
La première molécule d'ATP est produite par cette réaction qui a lieu grâce à la 3-phosphoglycérate transférase.
8. Mutation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate
Par la phosphoglycérate mutase, il se réalise l'isomérisation par translocation du groupement phosphate (P) de la position 3 à la position 2 sur le glycérate.
9. Passage du 2-phosphoglycérate en phosphoénolpyruvate
Ici déjà, on commence à y voir plus clair parce qu'en fin de compte, on commence à voir le pyruvate apparaître.
C'est une réaction d'hydratation mediée par une hydratase ou une enolase.
10. Transfert du phosphate du phosphoénolpyruvate à l'ADP pour obtenir l'ATP.
C'est la très célèbre Pyruvate Kinase qui se charge de la réalisation de cette réaction.
Cette étape aboutit à la formation de l'ATP et comme vu à la 7è étape, nous aurons un total de 2 ATP. Ainsi, tout le compte fait, le bilan fait état de 2ATP et 2NADH ainsi que 2H+.
Les NADH n'interviendront dans la production d'énergie que s'ils connaissent l'effet mitochondrial pour fournir l'énergie nécessaire. Actuellement, on pense que un NADH ne produirait l'équivalent de moins de 3 ATP comme on l'avait supposé autrefois.
B. LA DÉCARBOXYLATION OXYDATIVE DU PYRUVATE
Le pyruvate ainsi obtenu est, dans le cas d'aérobie (dans la mitochondrie), décarboxylée en Acétyl-coA. Comme le nom de la réaction l'indique, il se passe une perte de groupement carboxyl du pyruvate par oxydation de ce dernier. C'est grâce à la pyruvate déshydrogénase.
Cette réaction produit 1NADH et 1H+.
Le bilan est de 2NADH et 2H+ puisqu'il s'agit, si vous n'avez pas perdu de vue, de deux molécules de pyruvate issus de la glycolyse qui donnent deux Acétyl-coA
C. CYCLE DE KREBS
(*Synonymes: cycle du citrate ou de l'acide citrique)
Ensuite vient le cycle de Krebs au cours duquel chacun de 2 acétyl-coA produit 3NAD+1FAD+1GTP.
Bilan énergétique total du cycle de Krebs: 6NADH+2FADH+2GTP.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE D'UNE MOLÉCULE DE GLUCOSE
La sommation énergétique donne: 10 NADH, 2FADH+2ATP+2GTP. Sachant que l'énergie issue de
- NADH équivaut à 2,5 molécules d'ATP,
- FADH à 1,5 molécule d'ATP,
- GTP à 1 molécule d'ATP,
on a en terme de pouvoir énergétique, un équivalent de (10x2,5ATP)+(2x1,5)+2+(2x1ATP)= 32 ATP.
Autrefois, les ouvrages parlaient de 38 ATP suite à une majoration du rendement énergétique de 0,5 ATP pour le NADH et le FADH.
III. IMPLICATIONS PATHOLOGIQUES
Les 2 implications pathologiques les plus connues sont:
- le cas de nécrose en anaérobie (insuffisance d'ATP). Sur 32 ATP attendus (dont 30 de la Décarboxylation et le cycle de Krebs), en cas d'ischémie voire d'anémie sévère, on ne se limite qu'à la production de 2ATP à la glycolyse anaérobie>> anergie cellulaire>> ralentissement métabolique et arrêt des processus de détoxification>> nécrose.
- l'anémie par hémolyse en cas déficit en pyruvate kinase: pas d'ATP>> anergie érythrocytaire avec principalement la dysfonction de la pompe Na/K ATPase>> accumulation cytosolique de Na+ >>> Osmose par effet osmotique efficace du sodium en intracellulaire>>> Engorgement d'eau dans le GR>>> Eclatement érythrocytaire (Hémolyse)>>> Anémie...
CAP KABA WhatsApp Forum, Biochimie de la glycolyse par Kevy Nguya